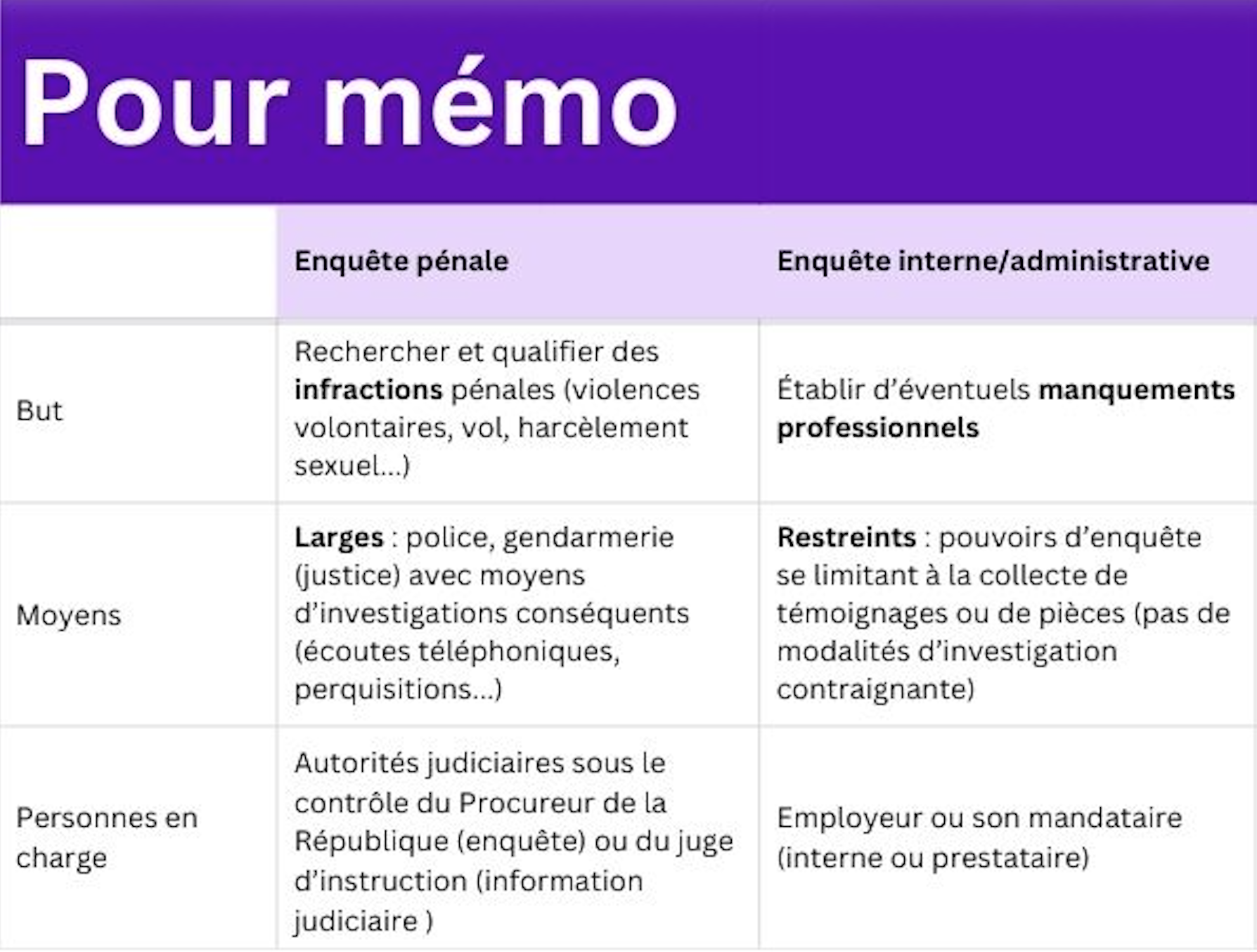Quand la mobiliser ? Est-elle obligatoire ? Quel est son objectif ?
Faisons le point.
1️⃣ L’employeur peut mobiliser une enquête interne dans plusieurs cas de figure :
✅ Il a un doute sur une situation et notamment sur sa matérialité
Exemple : des comportements laissent penser qu’un collaborateur adopte des comportements harcelants, mais rien n’est formellement établi.
✅ Il a une certitude, mais souhaite connaître l’ampleur des faits
Exemple : un cas de harcèlement est avéré, l’employeur s’interroge sur l’existence d’autres victimes potentielles.
2️⃣ L’évolution jurisprudentielle sur l’obligation d’enquête
📌 Dès 2005, la jurisprudence administrative considère l’enquête comme un moyen parmi d’autres de rechercher des éléments matériels comme preuve d’agissements fautifs (CAA Douai, 5 juillet 2005, Mme Suzanne X, n°04DA00555).
📌 En 2019, la Cour de cassation estime l’enquête obligatoire pour tout employeur qui a connaissance de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement. À défaut, la situation est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).
📌 En 2024, la Cour de cassation nuance sa posture, et estime que l’enquête n’est pas une mesure obligatoire. Elle reste toutefois un moyen recommandé, l’employeur devant avoir pris des mesures de nature à remplir son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975).
3️⃣ Dans tous les cas, le juge vérifie que l’enquête soit conduite de manière rigoureuse, sérieuse, impartiale.
Une enquête interne maladroite et partiale constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631).
4️⃣ L’objectif d’une enquête interne n’est pas de qualifier juridiquement des infractions pénales, mais de matérialiser et caractériser des manquements professionnels.
Le Conseil d’État a indiqué qu’il importe peu à l’employeur public de qualifier juridiquement des faits, dès lors que ceux-ci sont caractérisés au regard des manquements aux obligations professionnelles des agents (CE, 12 avril 2021, n°435774).
Cette distinction est cruciale car elle permet de :
✅ Sécuriser la démarche de l’employeur, en s’attacher à caractériser des fautes professionnelles
✅ Éviter les erreurs de qualification juridique
✅ Se concentrer sur ce qui relève de la responsabilité employeur
✅ Sanctionner disciplinairement sans attendre une condamnation pénale
En résumé :
L’enquête interne n’est pas strictement obligatoire, mais reste un moyen sûr pour l’employeur de remplir son obligation de sécurité, à la condition qu’elle soit conduite selon une méthodologie structurée et éprouvée.